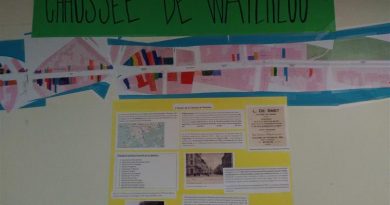Le Bund, une judéité sans Israël ? Retour sur un mouvement oublié
Alors que la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza se remet en marche (Tsahal violant l’accord de cessez-le-feu), alors que le président américain Donald Trump suggère une déportation massive des Gazaouis au profit d’une sorte de Côte d’Azur proche-orientale administrée par les États-Unis, et alors que les actes d’extrême violence contre les Palestiniens en Cisjordanie se multiplient et que les colons s’emparent de nouveaux hectares de terres palestiniennes, de nombreux activistes pour la cause palestinienne semblent perdre espoir.
Cette catastrophe humanitaire, dont l’origine remonte à la guerre israélo-arabe de 1948-1949, et qui a été considérablement aggravée par les attaques du 7 octobre 2023, paraît insurmontable. D’une part, en raison de l’approvisionnement quasi illimité en armement américain dont bénéficie Israël ; d’autre part, à cause de l’inaction de la communauté internationale, qui tarde à appliquer les mesures recommandées par la Cour Internationale de Justice (CIJ).
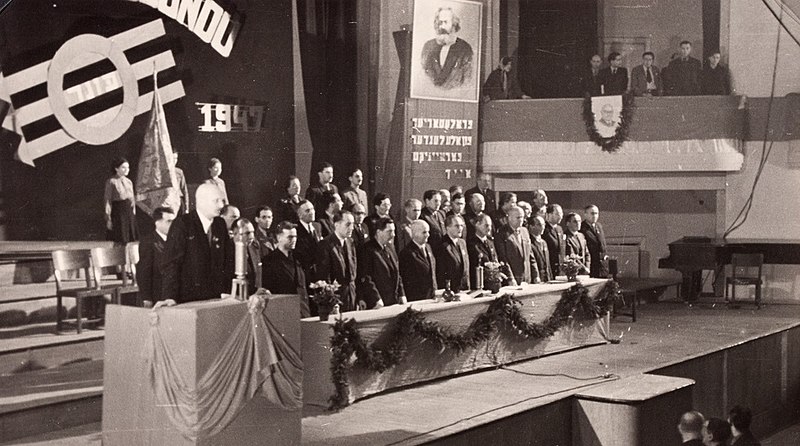
Israël, s’il ne les dément pas, justifie ses exactions en affirmant les commettre au nom de la protection du peuple juif, dont il serait le représentant suprême. Sa doctrine d’Etat, le sionisme, théorisée par Theodor Herzl à la fin du 19ème siècle, est présentée comme l’ultime solution à l’antisémitisme. Après la Shoah, la Palestine mandataire, « terre sans peuple pour un peuple sans terre », serait devenue l’unique refuge des Juifs. L’établissement d’un État-nation pour les Juifs, bien qu’on sache maintenant par quels moyens les milices sionistes ont établi une « majorité » pendant la Nakba, serait ainsi la seule manière de garantir la sécurité des Juifs.
Le sionisme, unique projet politique juif ?
Pourtant, peu savent que le sionisme n’a pas toujours été le mouvement politique majoritaire au sein de la communauté juive d’Europe. À ses débuts, il y était d’ailleurs très minoritaire. Le mouvement dominant sur la scène politique juive ashkénaze, en Europe centrale et orientale, était alors l’Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie socialiste, communément appelée « le Bund » (« union » en Yiddish).
Parti socialiste et autonomiste, le Bund n’aspirait pas à la création d’une colonie juive en Palestine, mais à la révolution sociale et à l’émancipation des Juifs en Europe. Cet article tentera de retracer l’histoire de ce mouvement fascinant, dont les exploits permettent non seulement de mieux comprendre les enjeux actuels au Proche-Orient, mais aussi de démentir la supposition selon laquelle le judaïsme (la religion juive) ou la judéité (qui renvoie à l’identité juive) seraient automatiquement synonymes de sionisme.
Le Bund, mouvement de lutte(s)
Fermement implanté dans les centres industriels et urbains d’Europe de l’Est, le Bund était un mouvement socialiste juif créé en 1897 à Vilnius, ville faisant alors partie de la Russie impériale. Il avait pour principal but de réunir tous les travailleurs juifs de l’empire dans une seule organisation afin de mieux représenter la volonté du prolétariat juif et ses intérêts spécifiques dans une Russie rongée par un antisémitisme d’Etat et un capitalisme en plein essor dans les grandes villes. Il comptait à son apogée, en 1905, plus de 30 000 membres.
Si la lutte des classes était un élément central de son engagement, le Bund était aussi confronté à l’horreur des pogromes, massacres antijuifs commandités par les autorités tsaristes. Le plus violent de l’époque fut celui de Kichinev (ou Chisinau, capitale actuelle de la Moldavie), qui s’est déroulé du 6 au 7 avril 1903. À l’initiative du ministre de l’Intérieur, von Plehve, il avait été organisé par l’administration bessarabienne, qui administrait alors la région comprenant l’actuelle Moldavie et certaines parties de l’Ukraine. L’historien français H. Minczeles fait un état des lieux : « [Le pogrome de Kichinev] fit 49 morts et plus de 500 blessés. 700 maisons, 600 boutiques, fabriques et ateliers furent pillés et dévastés. 2000 familles se retrouvèrent sans abri. Malgré une brève riposte des bouchers juifs, les émeutiers mirent à sac le quartier juif, tuant, violant et pillant. »
Le Bund créa donc des escouades anti-pogromistes, appelées BO (Boevie Otriady). Elles se propagèrent dans toutes les grandes villes de l’Empire et rassemblèrent progressivement un réel arsenal militaire. Une action notable des BO fut la riposte juive à Gomel, où celles-ci se confrontèrent aux pogromistes et, comme l’indique ce même historien, « leur infligèrent une sérieuse raclée » !
Les BO furent aussi mobilisées pour la protection de synagogues et de meetings politiques ainsi que le maintien de l’ordre dans les manifestations. « Pour la judaïcité, ces contre-attaques furent une révélation ; pour les non-Juifs, un sujet d’étonnement ; pour les pogromistes, de la stupeur ! »
Le Bund, acteur politique majeur au sein de la gauche russe
Membre fondateur du Parti ouvrier social-démocrate russe (POSDR), l’ancêtre du Parti Communiste de l’Union Soviétique (PCSU), le Bund insiste alors sur son droit exclusif pour représenter la nation juive au sein du parti jusqu’au congrès de 1903. Le 2ème congrès du POSDR se déroule entre Bruxelles et Londres du 30 juillet au 23 août 1903. C’est un évènement important dans l’histoire de la révolution russe car il donnera entre autres naissance aux factions menchéviques et bolchéviques. Sur les 43 délégués présents, 5 font partie du Bund.
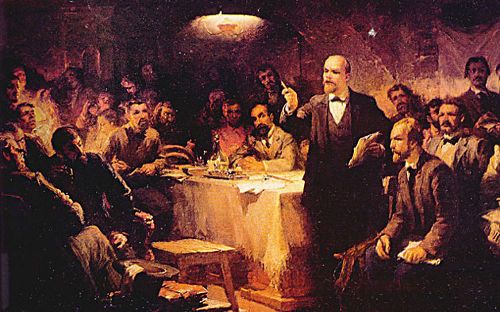
Lors de la 27ème session, les menchéviques et bolchéviques rejetteront le droit du Bund à l’autonomie nationale, avançant qu’un juif voulant adhérer à la social-démocratie devrait adhérer au Bund, qui lui ensuite sera fédéré avec le parti russe. Même si cela peut sembler futile, les iskristes (partisans de la révolution et opposants à la faction économiste du parti, prônant la simple lutte pour l’amélioration des conditions de vie immédiate des ouvriers) pensaient qu’une telle organisation fédérée et non centralisée du parti accentuerait les divisions internes et ainsi fracturerait le mouvement. Il serait, d’après eux, contreproductif de ne laisser qu’au Bund le droit de représentation de la classe ouvrière juive, d’autant plus que de nombreux juifs figuraient chez les menchéviques et bolchéviques (dont Martov et Trotsky).
De plus, si le Bund obtenait une autonomie nationale, cela pourrait inciter d’autres ethnies (Polonais, Ukrainiens, Kazakhs, etc.) à revendiquer une indépendance et ainsi dévaluer l’identité de classe comme fondement du parti par rapport à l’identité nationale. Ainsi, cette position centralisatrice est compréhensible, compte tenu du manque d’organisation qui rongeait la mouvance socialiste russe, empêchant toute action coordonnée. A la suite du vote sur le maintien du fédéralisme, rejeté à 41 voix contre et 5 abstentions, le Bund quitte le congrès et ainsi le POSDR.
Il continue néanmoins ses activités en parallèle mais finit par réintégrer le parti social-démocrate en 1906. Fort de plus de 30 000 membres pendant la révolution russe de 1905, épisode contestataire aboutissant à certaines libertés politiques accordées par le Tsar, le Bund impressionne le POSDR et est réadmis. Ses demandes sont partiellement accordées : il doit accepter le programme du parti mais garde une grande indépendance organisationnelle.
Hélas, le 3 juin 1907, le coup d’état institutionnel de Stolypine, premier ministre du tsar qui renonce à toutes les avancées de 1905, s’abat sur le mouvement ouvrier. Les Cent-Noirs (proto-fascistes russes), les monarchistes et conservateurs s’allient pour la préservation de l’autoritarisme, et le Bund voit ses membres émigrer de Russie ou simplement quitter le parti, craignant de possibles représailles. A la fin de 1908, il ne lui reste que quelques centaines de membres.
Révolutions de 1917 : alliances et scissions
Après la révolution de février 1917, marquant la fin du tsarisme en Russie et laissant place à un Gouvernement provisoire, les minorités de l’empire, Juifs compris, reçoivent enfin les mêmes droits que les Russes. Cette égalité formelle, ainsi qu’une multitude de nouvelles libertés politiques, permettent au Bund d’enfin sortir de la clandestinité. Son nombre d’adhérents retrouve son niveau de 1905 et il devient une force politique importante au sein des conseils de travailleurs, plus connus sous le nom de soviets.

Les soviets deviennent progressivement la principale opposition au Gouvernement provisoire, dont l’inaction face aux revendications des paysans et des travailleurs devient de plus en plus évidente. En octobre de la même année, alors que ce qui reste du Gouvernement provisoire a perdu toute légitimité politique, les bolchéviques de Vladimir Lénine, au nom des soviets, prennent le pouvoir par un coup d’État en octobre 1917 (novembre pour notre calendrier grégorien).
Le reste de la gauche, y compris le Bund, condamne fermement ces actions. Menchéviques, socialistes-révolutionnaires et courants gauchistes de tout genre se lancent alors, en s’alliant avec les « Blancs » (royalistes et antisémites notoires) et certaines puissances extérieures (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, etc.) dans une guerre contre les bolchéviques.
Mais cette guerre civile frappe la communauté juive de plein fouet par une violence antisémite sans précédent. Les pogromes qui s’y déroulaient étaient sans commune mesure avec ceux des années 1880 à 1905. H. Minczeles indique que « pour la période de 1917 à 1921, on dénombra 1236 actes de violence dans 700 localités, environ 60 000 Juifs tués et un demi-million de sinistrés. Les statistiques soviétiques firent état de 180 000 à 200 000 victimes. ». Les bundistes se tournent donc vers les bolchéviques communistes et, au sortir la guerre civile en 1922, une fois triomphants, fusionnent progressivement avec les bolchéviques, rebaptisés Parti Communiste de l’Union Soviétique (PCUS).
Le Bund polonais
Bien que le Bund ait été pratiquement dissous dans la toute nouvelle Union soviétique, concurrencé par la branche juive du PCUS, la Yevsektsia, il reste actif en Pologne, indépendante de la Russie depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il participe notamment aux élections municipales où, après une lutte acharnée, il triomphe en 1938. H. Minczeles décrit ainsi l’incroyable victoire du Bund : « Dans le pays, plus de 60 % des voix se portèrent sur les listes bundistes. A Lodz, on comptait 11 conseilleurs municipaux sur 17. A Wilno, Cracovie, Lublin, Grodno, Bialystok, Tarnow, Radom, le raz de marée avait tout balayé. Sur 89 villes et [villages], plus d’un tiers obtinrent une majorité absolue bundiste. »
Cette victoire ne dure pourtant que peu longtemps car le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahissent la Pologne. Le mouvement bundiste tente tout de même de survivre avant d’être entièrement décimé pendant la Shoah. Le génocide nazi marque non seulement la destruction des Juifs d’Europe mais aussi de ses mouvements ouvriers de masse. Néanmoins, certains émigrés ont préservé la flamme yiddishiste en fondant des factions bundistes en Europe de l’Ouest et aux États-Unis. Ces factions bundistes peinent tout de même à se maintenir, notamment vers la fin du 20ème siècle.
Un héritage réhabilité

Mais la mouvance bundiste connaît un regain d’intérêt depuis l’aggravation de l’occupation israélienne, marquée par une succession de guerres et de rébellions. La nouvelle guerre d’extermination menée à Gaza par les forces israéliennes depuis octobre 2023 a non seulement fait émerger un mouvement propalestinien international, que l’on pourrait comparer à celui en soutien au Vietnam dans les années soixante, mais elle a également ravivé, au sein des sphères juives, le débat sur la légitimité des exactions israéliennes depuis la création de l’État en 1947.
Selon le think tank Brookings, plus de 43 % des personnes juives de moins de 40 ans aux États-Unis estiment que le traitement réservé par Israël aux Palestiniens est comparable au racisme systémique aux États-Unis, et 33 % considèrent qu’Israël commet un génocide.
Le Bund connaît ainsi une réhabilitation progressive, portée par certaines organisations comme le réseau « European Jews for Palestine », qui coordonne les actions de multiples associations juives propalestiniennes en Union européenne. Aux États-Unis, l’association « Jewish Voice for Peace » mène de nombreuses actions de désobéissance civile dénonçant la complicité américaine avec ce qu’elle qualifie de génocide. Par exemple, ses membres ont occupé la Trump Tower en mars dernier, et ont coordonné en octobre 2023 un rassemblement de dix mille personnes sous la bannière « Juifs contre le génocide », conduit par plus de vingt rabbins et rabbines devant, et à l’intérieur, du Capitole américain.
Bien que le Bund n’ait jamais réellement existé en tant que parti depuis la Shoah et, par conséquent, la création de l’Etat d’Israël, ses idées connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt chez une jeunesse juive indignée par l’oppression du Proche-Orient par les puissances impérialistes. Ainsi, il traverse les âges, colorant la yiddishkeit d’un rouge anti-impérialiste et démystifiant le paradigme sioniste en occident.
David Schreiber / S6FRC / EEB1 Uccle
Références
Achcar, Gilbert. « Arthur Balfour était bien l’ennemi des Juifs ». Le Monde Diplomatique, MAV n°157. Consulté le 18 février 2025.
Commons. « A Short History of the Jewish Bund ». Commons.com.ua. Consulté le 18 février 2025.
Jacobin. « The Jewish Bund: Nationalism, Socialism, and the Jews ». Jacobin Magazine, 2017. Consulté le 18 février 2025.
International Socialism. « The Rise and Fall of the Jewish Labour Bund ». International Socialism Journal. Consulté le 18 février 2025.
Cliff, Tony. « Le deuxième congrès du POSDR ». Marxists Internet Archive, 1989. Consulté le 18 février 2025.
Left Voice. « The Oath: The Story of the Jewish Bund ». Left Voice. Consulté le 18 février 2025.
Tenoua. « Other Promised Lands ». Tenoua.org. Consulté le 18 février 2025.
Verso Books. « A Jewish Socialist Critique of Zionism from 1906 ». Verso Books Blog. Consulté le 18 février 2025.
Médecins Sans Frontières. « Cisjordanie : un nouveau rapport d’AZG dénonce les entraves aux soins et les violences ». Médecins Sans Frontières Belgique. Consulté le 18 février 2025.
Livre
Minczeles, Henri. Histoire Générale du Bund. Paris : Éditions Denoël, 1999.